Cette recension a été publiée dans le numéro d’été 2025 de Politique étrangère (n° 2/2025). Élodie Riche propose une analyse de l’ouvrage de Carlos Lopes, The Self-Deception Trap: Exploring the Economic Dimensions of Charity Dependency within Africa-Europe Relations (Palgrave Macmillan, 2024, 260 pages).

Ce livre porte avant tout sur les relations entre l’Europe et l’Afrique. Pour l’auteur, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, c’est dans la relation coloniale que s’est jouée la place actuelle de l’Afrique dans le commerce mondial. C’est là que s’est mis en place ce « piège de l’auto-illusion », empêchant la transformation des économies africaines via des représentations touchant à la fois les Européens, initiateurs du système économique mondial, mais aussi les élites africaines, plus soucieuses de répondre aux injonctions des bailleurs extérieurs qu’à leur population.
Du côté des Européens, Carlos Lopes déroule avec une belle bibliographie toute l’histoire des rapports inégaux imposés par la colonisation, via la force mais aussi les représentations partagées. Le livre suit chronologiquement les étapes de cette relation, développant le désormais bien documenté enrichissement de l’Europe par le commerce triangulaire, et sa dimension culturelle et psychologique, avec des auteurs africains ou du Sud, notamment Fanon et Cabral.
Il revient sur l’histoire de l’aide au développement, sa proximité initiale avec la notion de charité, l’accent mis dans les années 1980 sur les réformes et l’efficacité de l’aide, puis le retour à l’idée de l’aide comme compensation, avec l’apparition des biens publics mondiaux. La vision est critique : l’aide et son insistance croissante sur la bonne gouvernance renforcent la dépendance et véhiculent l’idée d’une Afrique incapable de répondre à ses besoins.
Surtout, elle accompagne pendant toute la période une politique commerciale européenne basée sur les avantages comparatifs et la spécialisation dans les matières premières, qui a empêché l’émergence d’une industrie et l’insertion de l’Afrique à bon niveau dans les chaînes de valeur mondiales. On suit avec intérêt la comparaison avec l’Asie et son ouverture économique associée à des politiques industrielles fortes. Le cœur du propos de Lopes intervient alors, lorsqu’il dénonce la renégociation de l’accord de Cotonou entre l’Union européenne et six régions du groupe ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), la première refusant de traiter avec l’Union africaine. Il voit là une stratégie délibérée pour affaiblir l’Afrique. Il considère la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) comme une chance de réinstaurer une égalité pour des effets transformateurs.
Le propos panafricain est bien défendu mais une partie du pari annoncé n’est pas tenu : le double piège de l’auto-illusion tourne à sens unique, la majorité des arguments portant contre l’Europe, accusée de malhonnêteté notamment dans l’épisode de Cotonou. La responsabilité des élites africaines est rapidement évacuée, dont la question de la corruption jugée non pertinente pour comprendre les difficultés de l’Afrique à changer son économie.
Lopes redéploie la théorie des termes de l’échange inégaux. Si celle-ci reste toujours valable, elle n’explique pas la self-illusion des Africains. Le livre doit cependant être lu, dans la mesure où cette relation économique inégale est au cœur des revendications souverainistes actuelles. Il vaut aussi pour son retour historique, notamment sur l’aide, sa revue de littérature critique incluant de nombreux auteurs du Sud et sa vision globale des enjeux africains.
Élodie Riche

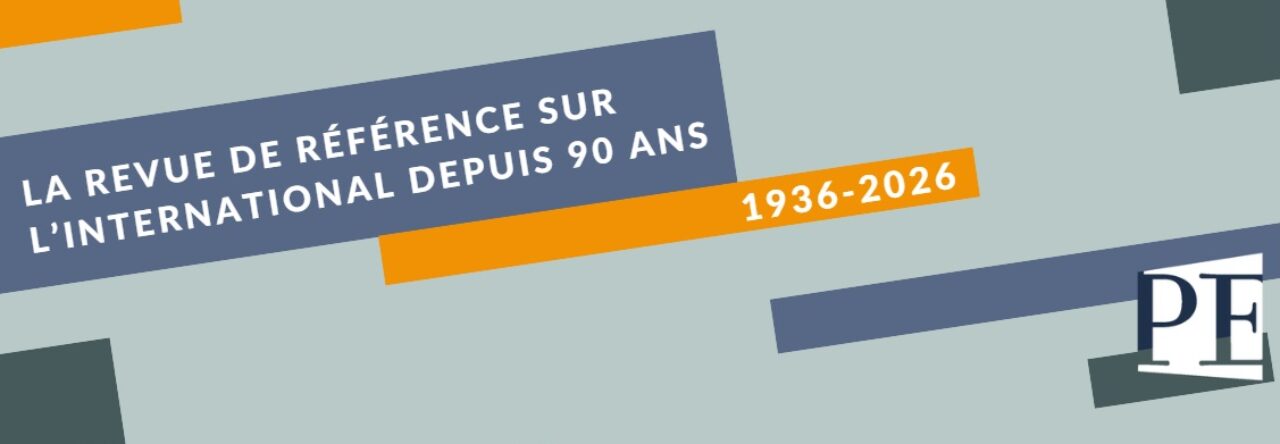
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.