Norbert Gaillard est économiste, consultant indépendant et spécialiste du risque souverain et du risque pays. Il a écrit l’article « Le nationalisme économique de Donald Trump » dans le n° 3/2025 de Politique étrangère. Il répond ici en exclusivité à 3 questions pour politique-etrangere.com.

1. En quoi l’agenda protectionniste de Donald Trump constitue-t-il un « tournant majeur pour l’économie mondiale » ?
La politique protectionniste de Donald Trump dévoilée lors du Liberation Day du 2 avril 2025 vient interrompre le processus de globalisation débuté il y a près de 40 ans. En tenant compte des mesures protectionnistes en vigueur à la mi-septembre, on observe que le taux moyen effectif global des droits de douane sur les biens importés aux États-Unis dépasse désormais les 17 % contre 2,5 % environ à la fin de la présidence de Joe Biden. Le taux actuel n’a jamais été aussi élevé depuis 1935 !
Mais au-delà des chiffres, c’est la méthode Trump qui crée une rupture historique. En appliquant des droits de douane différents selon les pays, les autorités américaines violent un principe fondamental de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : celui de la clause de la nation la plus favorisée qui prévoit que les pays ne peuvent pas établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. En fait, l’agenda protectionniste de Trump remet ouvertement en cause le multilatéralisme commercial et illustre de façon spectaculaire la volonté américaine de « bilatéraliser » les relations économiques internationales. Ces droits de douane obligent les entreprises qui exportaient traditionnellement aux États-Unis à réviser leur stratégie. Elles peuvent continuer à exporter outre-Atlantique mais doivent rogner leurs marges ou maintenir leurs prix inchangés, au risque de voir leurs ventes chuter. Elles sont aussi susceptibles de réorienter leurs exportations vers d’autres pays. Cela implique des études de marché approfondies et la prise en compte d’un regain de concurrence sur ces marchés « alternatifs ». Dernière option, renoncer aux exportations et investir directement aux États-Unis. C’est précisément ce que souhaite Donald Trump mais le climat des affaires sur place est loin d’être favorable, surtout pour des entreprises industrielles contraintes d’importer des matières premières surtaxées et désireuses d’embaucher de la main-d’œuvre non américaine.
2. Pour les États-Unis, quels sont les risques à court, moyen et long termes de la politique commerciale menée par Trump ?
Si les droits de douane restent en l’état, la croissance du produit intérieur brut (PIB) serait amputée de 0,5 point pour cette année et l’année prochaine. Le taux de chômage augmenterait de 0,3 point en 2025 et de 0,6 point en 2026. Les effets sur les prix à la consommation seraient significatifs. Par exemple, à court terme, le prix des automobiles, des biens de consommation électroniques, des équipements électriques et des vêtements bondirait respectivement de 12 %, 17 %, 23 % et 35 %. Les ménages modestes seraient les plus touchés par cette poussée inflationniste.
À moyen et long termes, le taux de croissance du PIB serait réduit de 0,4 point chaque année jusqu’en 2034. La hausse des prix des automobiles, des biens de consommation électroniques, des équipements électriques et des vêtements apparaîtrait plus modérée mais s’échelonnerait entre 6 % et 13 %. À long terme, on assisterait à une redistribution des cartes entre secteurs d’activité. La production manufacturière rebondirait tandis que l’industrie minière et le secteur de la construction seraient en berne. Les droits de douane posent cependant un autre problème. Depuis avril, les revirements et atermoiements de Donald Trump ont désorienté les partenaires des États-Unis. L’administration républicaine sait-elle vraiment ce qu’elle veut ? Y a-t-il un risque de surtaxe douanière si le gouvernement du pays partenaire prend des décisions qui déplaisent à la Maison-Blanche ? Les entreprises européennes peuvent-elles engager des investissements directs aux États-Unis sans craindre de subir des discriminations fiscales ou réglementaires ? À ces incertitudes s’ajoute le risque de voir les tarifs douaniers instaurés sur la base de l’International Emergency Economic Powers Act invalidés par la Cour suprême dans les prochains mois. Une telle censure serait un camouflet pour Trump car ces tarifs représentent 71 % de la totalité des droits de douane annoncés ces derniers mois.
3. Comment interpréter la dégradation de la note souveraine des États-Unis par Moody’s en mai dernier et les tensions récurrentes concernant la Réserve fédérale ?
À travers ces différents événements, ce sont la solvabilité des États-Unis et le soutien à l’activité économique outre-Atlantique qui se jouent. La notation souveraine américaine reste encore très élevée (l’équivalent d’un 19/20) mais l’analyse de Moody’s est assez préoccupante. L’agence considère que l’administration américaine ne réduira pas le déficit budgétaire à moyen et long termes. Plus grave, elle prévoit que le paiement des intérêts devrait absorber 30 % des recettes d’ici 2035, contre 18 % en 2024 et 9 % en 2021. De même, le ratio de dette publique s’envolerait de 98 % en 2024 à 134 % en 2035. Si cette tendance se confirme dans les deux ou trois prochaines années, d’autres abaissements de note surviendront inéluctablement.
Donald Trump est tout à fait conscient de cette dérive des comptes publics, mais il refuse tout processus de « deleveraging » qui pourrait entraîner une récession. Par conséquent, il a décidé d’activer deux leviers pour stimuler la croissance : le dollar et les taux d’intérêt. D’une part, l’administration républicaine encourage la dépréciation du dollar, via précisément le creusement du déficit budgétaire et la volonté affichée de réduire le déficit commercial. C’est ainsi que le billet vert s’est déprécié de 5 % par rapport à l’euro dans les deux semaines qui ont suivi le Liberation Day. D’autre part, la Maison-Blanche fait pression sur la Réserve fédérale (Fed) pour qu’elle baisse ses taux. Une telle ingérence n’est pas inédite puisque Richard Nixon l’avait pratiquée pour assurer sa réélection en 1972. Néanmoins, Donald Trump est allé beaucoup plus loin : après avoir critiqué et insulté le président de la banque centrale, il a nommé un de ses conseillers (Stephen Miran) au conseil des gouverneurs de la Fed. Celle-ci a déjà procédé à une baisse de taux mais Trump l’a jugée insuffisante. À terme, il souhaite des taux proches de zéro et vise sans doute un financement direct du Trésor par la Fed. Cette monétisation de la dette serait dangereuse car elle accroîtrait la défiance à l’égard du dollar et des titres libellés en dollars.
***
Lisez l’article de Norbert Gaillard, « Le nationalisme économique de Donald Trump » et retrouvez le sommaire du numéro 3/2025 ici.
> > Suivez-nous sur Twitter/X : @Pol_Etrangere < <

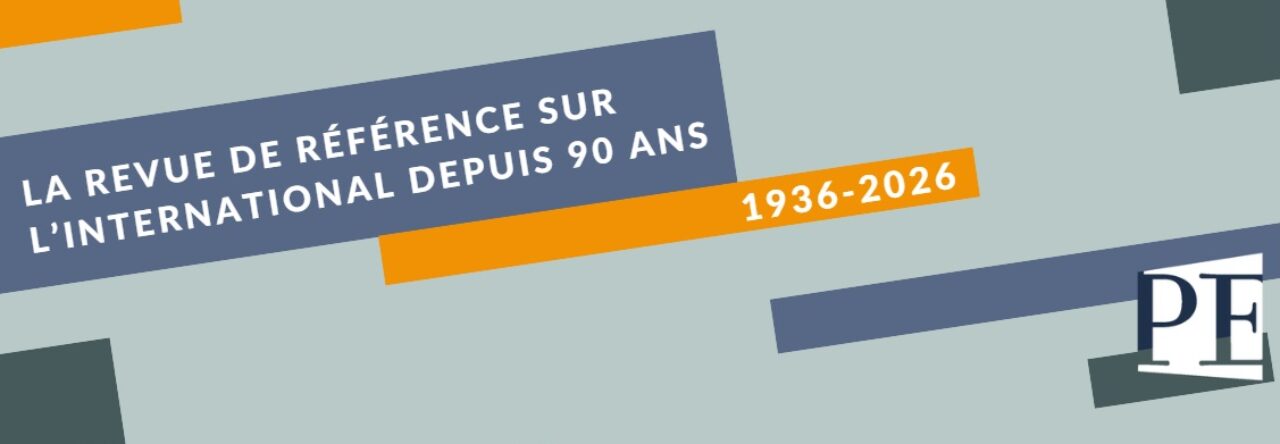
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.