Auteur de l’article « Le COVID-19, accélérateur de la post-mondialisation », paru dans le numéro d’automne de Politique étrangère (3/2020), Norbert Gaillard, docteur en économie et consultant indépendant, répond à 3 questions en exclusivité pour politique-etrangere.com.
1) Dans votre article, vous expliquez que le COVID-19 précipite l’ère de la post-mondialisation. En quoi cette nouvelle ère se différencie-t-elle de la précédente ?
La mondialisation présupposait une relative confiance entre États et impliquait une forte interdépendance. Elle a été le fruit d’un consensus sur le mode de développement économique le plus adéquat pour élever durablement le niveau de croissance (le célèbre « Consensus de Washington »). L’idée dominante était que les économies devaient « s’ouvrir » et exploiter leurs avantages comparatifs. Tout d’abord, s’ouvrir commercialement, c’est-à-dire accroître les exportations autant que possible et éviter les mesures protectionnistes. Ensuite, s’ouvrir financièrement et attirer les investisseurs étrangers.
Si on examine ces 30 années de mondialisation, on peut établir plusieurs constats. Premièrement, les grandes puissances économiques ont accepté la complémentarité et l’interdépendance. Deuxièmement, la plupart des pays émergents ont joué le jeu en renonçant aux nationalisations, très répandues jusque dans les années 1970. Troisièmement, la signature de crédit de ces mêmes pays s’est globalement améliorée car ils ont su maîtriser leur endettement, dompter l’inflation et emprunter de plus en plus dans leur propre devise. Quatrièmement, les principales crises survenues entre 1991 et 2019 ont été le résultat de surchauffes économiques, dues à des spirales spéculatives et d’endettement (crise asiatique de 1997, débâcle des subprimes en 2007-2008), ou des choix d’ouverture économique forcenée sans véritable réforme structurelle (banqueroutes argentine et grecque de 2001-2002 et 2010-2012). Ces chocs n’ont pu être contenus que par des efforts de coopération entre Fonds monétaire international (FMI), gouvernements du G7, banquiers centraux et créanciers internationaux.
La pandémie du COVID-19 a malheureusement servi de double révélateur. Elle a montré les carences des vieux pays industrialisés en matière médicale et technologique. Plus grave, on s’est aperçu que des partenaires économiques aussi incontournables que la Chine et les États-Unis, du moins sous l’égide de Donald Trump, instrumentalisaient la crise sanitaire à des fins politiques.
Lire la suite


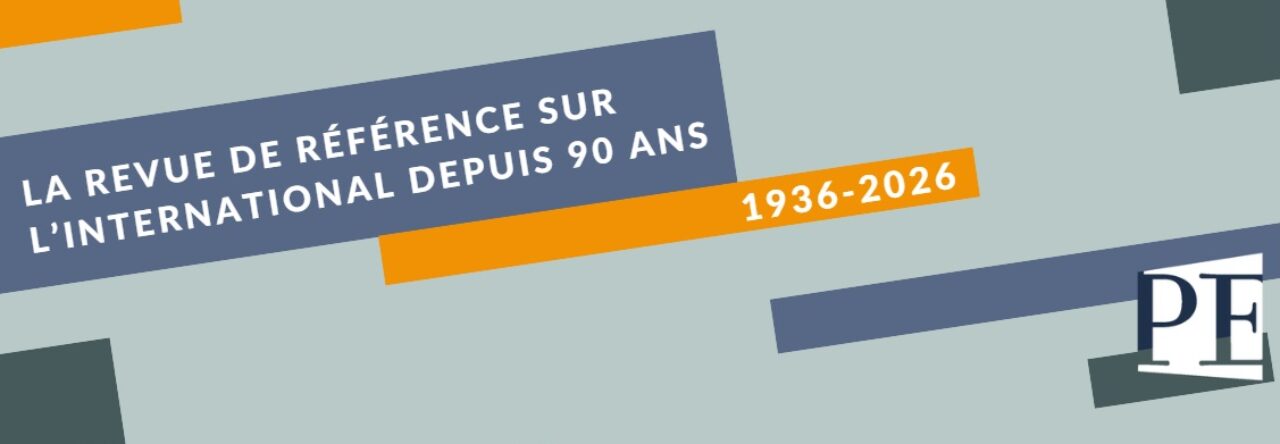



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.