Cette recension d’ouvrages est issue de Politique étrangère (1/2015). Marc Hecker propose une analyse croisée de deux ouvrages : celui de François Vignolle et Azzeddine Ahmed-Chaouch, La France du Djihad (Paris, Éditions du Moment, 2014, 208 pages) et celui de Dounia Bouzar, Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer (Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier, 2014, 176 pages).
 Depuis 2012 et la prise de contrôle par les rebelles de plusieurs postes-frontières, l’afflux de combattants étrangers n’a cessé d’augmenter en Syrie. À la fin 2014, près de 15 000 personnes ont ainsi rejoint les rangs de l’opposition à Bachar Al-Assad, dont environ 3 000 Occidentaux. Parmi ces derniers, les Français sont les plus nombreux. D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur en novembre 2014, plus de 1 000 ressortissants français étaient alors impliqués dans les filières syriennes.
Depuis 2012 et la prise de contrôle par les rebelles de plusieurs postes-frontières, l’afflux de combattants étrangers n’a cessé d’augmenter en Syrie. À la fin 2014, près de 15 000 personnes ont ainsi rejoint les rangs de l’opposition à Bachar Al-Assad, dont environ 3 000 Occidentaux. Parmi ces derniers, les Français sont les plus nombreux. D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur en novembre 2014, plus de 1 000 ressortissants français étaient alors impliqués dans les filières syriennes.

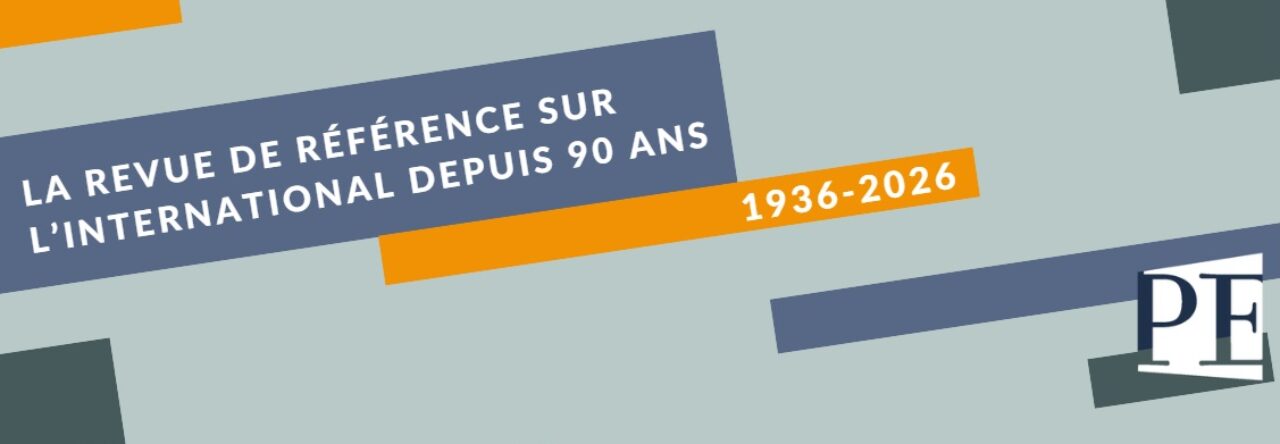
 La littérature sur l’adaptation militaire a connu un renouveau avec les conflits d’Irak et d’Afghanistan. Conçue comme un processus de changements organisationnels, doctrinaux et opérationnels en temps de guerre, l’adaptation a été analysée selon différentes échelles (institutions et unités sur le terrain) ou à partir de plusieurs variables (matérielles, culturelles, sociales, politiques). Eric Sangar s’intéresse ici au rôle de l’histoire dans ce processus. Amplement discutée dans les cercles militaires – notamment anglo-saxons –, la recherche d’enseignements par l’observation du passé demeure sous-théorisée. D’un côté domine une conception positiviste de l’histoire comme réservoir d’expériences dont il suffirait d’identifier les plus pertinentes. De l’autre, se retrouve une vision critique insistant sur le danger des métaphores et analogies.
La littérature sur l’adaptation militaire a connu un renouveau avec les conflits d’Irak et d’Afghanistan. Conçue comme un processus de changements organisationnels, doctrinaux et opérationnels en temps de guerre, l’adaptation a été analysée selon différentes échelles (institutions et unités sur le terrain) ou à partir de plusieurs variables (matérielles, culturelles, sociales, politiques). Eric Sangar s’intéresse ici au rôle de l’histoire dans ce processus. Amplement discutée dans les cercles militaires – notamment anglo-saxons –, la recherche d’enseignements par l’observation du passé demeure sous-théorisée. D’un côté domine une conception positiviste de l’histoire comme réservoir d’expériences dont il suffirait d’identifier les plus pertinentes. De l’autre, se retrouve une vision critique insistant sur le danger des métaphores et analogies. 
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.