Le nouveau numéro de Politique étrangère (2/2017) vient de paraître ! Il consacre un dossier complet à l’ASEAN qui fête ses 50 ans d’existence, tandis que le « Contrechamps » propose deux visions opposées sur les politiques économiques et budgétaires de la zone euro : Sous les dettes, la croissance ? Enfin, comme toujours, de nombreux articles viennent éclairer l’actualité, comme la Turquie, entre coup d’État et référendum ou encore le Brexit, représentatif d’une certaine idée de l’Europe.

En cinquante années d’existence, l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) a défini une approche complexe, progressive, équilibrée, de l’intégration régionale. Loin des affirmations spectaculaires de la construction européenne, elle articule les stratégies économiques et politiques d’États très divers avant tout soucieux de leurs propres souverainetés. La « voie asiatique » s’affirme ainsi très particulière, sans nul doute efficace. Mais suffira-t-elle face aux reclassements imposés par la montée en puissance du géant chinois ?

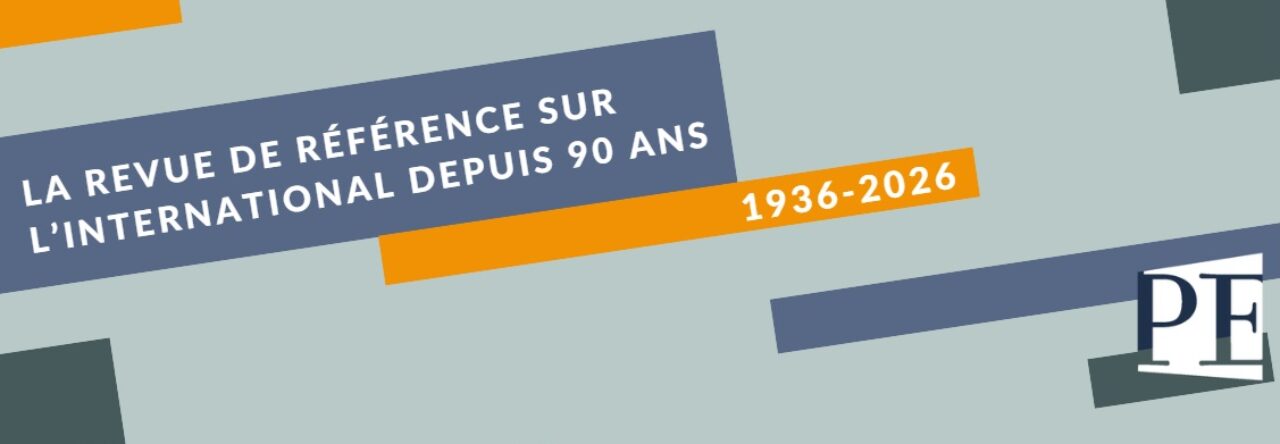


 Analysant chacun des six articles qui constituent ce dossier, l’auteur en fait une recension élogieuse et insiste sur son caractère fondamental et indispensable pour comprendre les enjeux de la crise moyen-orientale actuelle :
Analysant chacun des six articles qui constituent ce dossier, l’auteur en fait une recension élogieuse et insiste sur son caractère fondamental et indispensable pour comprendre les enjeux de la crise moyen-orientale actuelle :
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.