
Lisez l’article de Jean-Michel Severino ici.
Retrouvez le sommaire du numéro 1/2022 de Politique étrangère ici.
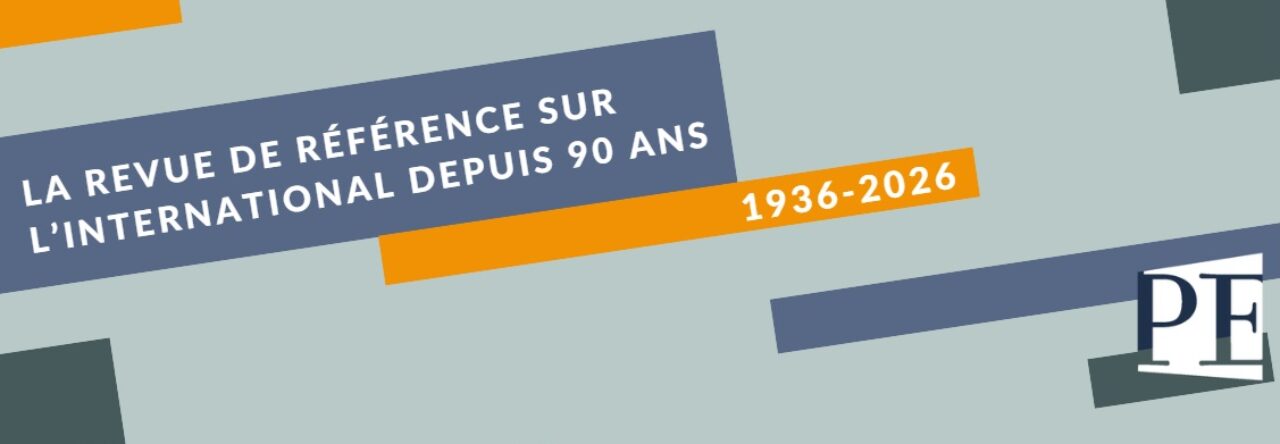
Le nouveau numéro de Politique étrangère (n° 3/2021) a fait sa rentrée cette semaine ! Il consacre un dossier spécial à la relation Europe/États-Unis, et un Contrechamps sur le climat vs. les enjeux de la sphère économique. Et comme à chaque nouveau numéro, de nombreux autres articles viennent éclairer l’actualité : la politique étrangère allemande et la fin du mandat d’Angela Merkel, la guerre contre le terrorisme, la position de l’administration Biden au Moyen-Orient, la Géorgie et son occupation…
***
Retrouvez le sommaire complet ici.
Lisez gratuitement :
***
> > Suivez-nous sur Twitter : @Pol_Etrangere ! < <
Le nouveau numéro de Politique étrangère (n° 3/2021) vient de sortir ! Il consacre un dossier spécial à la relation Europe/États-Unis, et un Contrechamps sur le climat vs. les enjeux de la sphère économique. Et comme à chaque nouveau numéro, de nombreux autres articles viennent éclairer l’actualité : la politique étrangère allemande et la fin du mandat d’Angela Merkel, la guerre contre le terrorisme, la position de l’administration Biden au Moyen-Orient, la Géorgie et son occupation…

Les États-Unis de Joe Biden en reviennent-ils à une diplomatie classique, multilatérale ? Leur posture plus ouverte ne gomme ni leurs problèmes internes ni les divergences d’intérêts qui les séparent des Européens : quelle diplomatie ouverte s’accordera avec la défense prioritaire des intérêts américains ? Washington organisera-t-il cette large coalition anti-chinoise dont se défient les Européens ? Les sanctions resteront-elles, avec leurs effets induits, au cœur des manœuvres américaines ? Les Européens pourront-ils, contre les mastodontes américains, affirmer leur souveraineté dans le domaine-clé des nouvelles technologies ?
Cette recension a été publiée dans le numéro d’été 2021 de Politique étrangère (n° 2/2021). Xenia Karametaxas propose une analyse de l’ouvrage dirigé par Paul G. Fisher, Making the Financial System Sustainable (Cambridge University Press, 2020, 300 pages).

Les marchés financiers constituent un levier indispensable pour relever les défis écologiques, sociaux et économiques de notre époque. En s’orientant vers des activités durables, les flux financiers peuvent servir de catalyseur pour accélérer la transition vers une économie soucieuse de l’environnement et de l’humain, fondée sur une gestion efficiente des ressources. Cinq ans après le lancement des trois initiatives historiques de la communauté internationale en faveur du développement durable – la signature de l’accord de Paris sur le climat, l’accord d’Addis-Abeba sur le financement du développement durable, et l’adoption des objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies (ONU) – ce livre vient opportunément faire le bilan sur les progrès réalisés et les écueils restant à surmonter.
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.