 Cette recension d’ouvrage est issue de Politique étrangère (2/2014). Olivier Louis propose une analyse de l’ouvrage de Husain Haqqani, Magnificent Delusions. Pakistan, the United States, and an Epic History of Misunderstanding, (New York, NY, Public Affairs, 2013, 416 pages).
Cette recension d’ouvrage est issue de Politique étrangère (2/2014). Olivier Louis propose une analyse de l’ouvrage de Husain Haqqani, Magnificent Delusions. Pakistan, the United States, and an Epic History of Misunderstanding, (New York, NY, Public Affairs, 2013, 416 pages).
Husain Haqqani publie un ouvrage consacré aux relations entre le Pakistan et les États-Unis. Successivement conseiller spécial de Nawaz Sharif lors de ses deux premiers mandats de Premier ministre, porte-parole de Benazir Bhutto, ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, conseiller proche du président Asif Ali Zardari, Haqqani vit aujourd’hui aux États-Unis, sous le coup d’une accusation de trahison lancée par l’armée pakistanaise et validée par la Cour suprême – mais non jugée –, à la suite d’une mystérieuse affaire (Memogate), dont l’objectif était sans doute de contraindre Zardari à la démission.
Ce dernier ouvrage ne le réconciliera pas avec ses deux bêtes noires, l’armée et la mouvance religieuse. Dans l’examen critique des politiques des deux États, c’est le Pakistan qui apparaît sous le plus mauvais jour. Naïveté, ignorance et complaisance sont les principaux reproches adressés aux États-Unis. Duplicité, paranoïa anti-indienne et mégalomanie islamiste, ceux dirigés contre le Pakistan. L’auteur analyse précisément la première période de l’histoire du pays, de Muhammad Ali Jinnah à la guerre indo-pakistanaise de 1965. Dès l’origine, la surévaluation de l’importance du Pakistan et le malentendu sur les objectifs de l’alliance américano-pakistanaise sont en germe. Sur le premier point, Haqqani rappelle qu’Ali Jinnah lui-même croyait que le Pakistan serait le « pivot du monde » et que les États-Unis auraient plus besoin du Pakistan que le contraire. Sur le second point, l’auteur raconte comment le maréchal Muhammad Ayoub Khan, au pouvoir de 1958 à 1969, réussit à convaincre les Américains de la gravité de la menace que l’Union soviétique était censée faire peser sur le Pakistan et du rôle essentiel d’Islamabad pour contrecarrer la « course vers les mers chaudes » de la diplomatie soviétique. En réalité, son seul objectif était d’obtenir, si possible gratuitement, les armes qui lui permettraient au moins de maintenir une parité stratégique avec l’Inde. Pendant l’âge d’or des relations avec Washington, entre 1958 et 1965, il obtint cet arsenal. Tout comme lui, ses successeurs jusqu’au départ du général Pervez Musharraf en 2008 n’ont conçu la relation avec les États-Unis que comme un moyen de renforcer leur pays contre la supposée menace indienne. L’auteur souligne une troisième composante de cette relation : la montée de l’antiaméricanisme dans la population, suscitée par l’armée elle-même afin qu’elle apparaisse comme le seul rempart contre le risque de dérive islamiste du pays. Ces trois traits se retrouvent dans les trois autres périodes fondamentales de la relation États-Unis/Pakistan : l’action conjointe des États-Unis et du Pakistan en Afghanistan (1978-1988), la crise résultant du programme nucléaire militaire du Pakistan (1989-1998) et la « guerre contre la terreur » (de 2001 à aujourd’hui).
Lire la suite
 La littérature sur l’adaptation militaire a connu un renouveau avec les conflits d’Irak et d’Afghanistan. Conçue comme un processus de changements organisationnels, doctrinaux et opérationnels en temps de guerre, l’adaptation a été analysée selon différentes échelles (institutions et unités sur le terrain) ou à partir de plusieurs variables (matérielles, culturelles, sociales, politiques). Eric Sangar s’intéresse ici au rôle de l’histoire dans ce processus. Amplement discutée dans les cercles militaires – notamment anglo-saxons –, la recherche d’enseignements par l’observation du passé demeure sous-théorisée. D’un côté domine une conception positiviste de l’histoire comme réservoir d’expériences dont il suffirait d’identifier les plus pertinentes. De l’autre, se retrouve une vision critique insistant sur le danger des métaphores et analogies.
La littérature sur l’adaptation militaire a connu un renouveau avec les conflits d’Irak et d’Afghanistan. Conçue comme un processus de changements organisationnels, doctrinaux et opérationnels en temps de guerre, l’adaptation a été analysée selon différentes échelles (institutions et unités sur le terrain) ou à partir de plusieurs variables (matérielles, culturelles, sociales, politiques). Eric Sangar s’intéresse ici au rôle de l’histoire dans ce processus. Amplement discutée dans les cercles militaires – notamment anglo-saxons –, la recherche d’enseignements par l’observation du passé demeure sous-théorisée. D’un côté domine une conception positiviste de l’histoire comme réservoir d’expériences dont il suffirait d’identifier les plus pertinentes. De l’autre, se retrouve une vision critique insistant sur le danger des métaphores et analogies. 
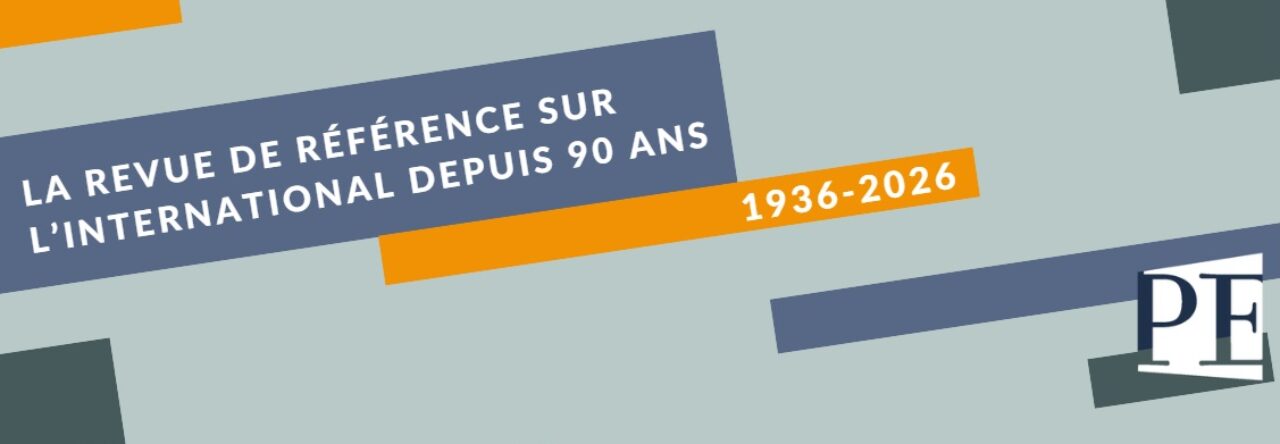



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.