Cette recension a été publiée dans le numéro d’été de Politique étrangère (2/2016). Aurélien Denizeau propose une analyse de l’ouvrage de M. Sükrü Hanioglu, Atatürk (Paris, Fayard, 2016, 288 pages).
 Père fondateur de la république de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk a inspiré d’innombrables biographes plus ou moins talentueux, et l’on est tenté au premier abord de se demander s’il était nécessaire de lui consacrer un nouvel ouvrage. Tout n’a-t-il pas déjà été dit sur l’homme, de sa jeunesse d’officier idéaliste à ses multiples réformes, en passant par son rôle crucial dans la bataille des Dardanelles ?
Père fondateur de la république de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk a inspiré d’innombrables biographes plus ou moins talentueux, et l’on est tenté au premier abord de se demander s’il était nécessaire de lui consacrer un nouvel ouvrage. Tout n’a-t-il pas déjà été dit sur l’homme, de sa jeunesse d’officier idéaliste à ses multiples réformes, en passant par son rôle crucial dans la bataille des Dardanelles ?
Or c’est bien des récits stéréotypés aux limites de l’hagiographie que Sükrü Hanioglu, professeur d’histoire ottomane à l’université de Princeton, s’éloigne résolument. Le mythe kémaliste, encore très vivace en Turquie, a tendance à présenter Atatürk comme un visionnaire isolé, en avance sur son époque et ses contemporains. À travers sa « biographie intellectuelle », l’auteur entend tout d’abord nuancer cette approche. Il montre que les idées d’Atatürk étaient au contraire partagées, certes pas par la majorité des Ottomans mais par une frange non négligeable de sa génération, avide de sciences et de modernité. La vision kémaliste n’est pas une exception sortie de quelque intuition géniale, mais plutôt le prolongement des idées nouvelles apparues dans l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, idées que l’auteur présente en détail.
Suivant un plan vaguement chronologique, l’ouvrage s’intéresse largement aux penseurs ottomans et européens qui ont influencé le jeune Mustafa Kemal, et guidé ses actions ultérieures. Il éclaire en particulier l’éclectisme de ces sources, qui vont de l’obscur naturaliste allemand Ludwig Büchner à Ziya Gökalp, figure majeure du turquisme.

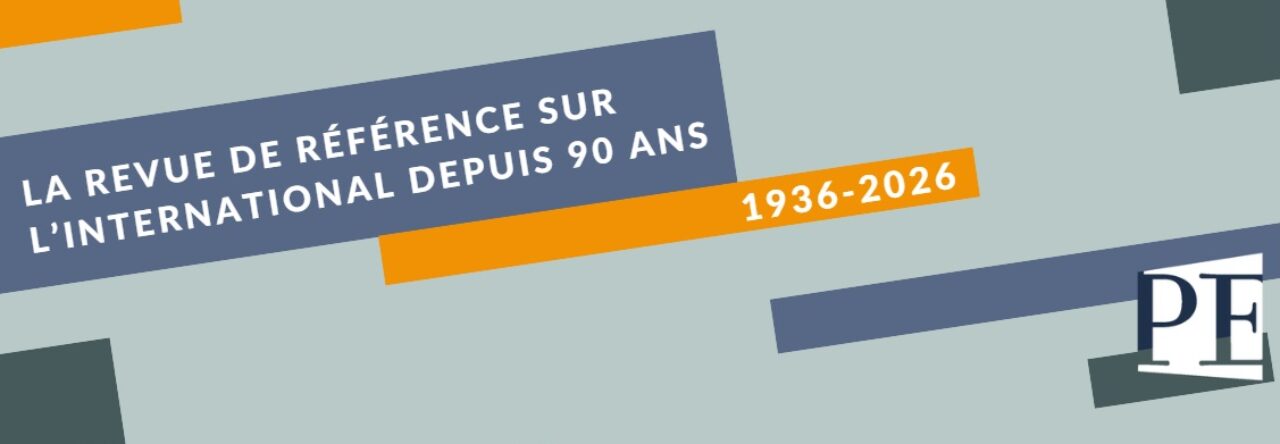
 Dans un paradoxe de l’Histoire, l’Union européenne et la Turquie ont dû se rapprocher pour faire face à la crise des réfugiés syriens. Un rapprochement qui semblait improbable il y a peu, tant les deux entités semblaient s’éloigner l’une de l’autre. Il intervient au moment où le président Recep Tayyip Erdogan glisse de plus en plus vers l’instauration d’un régime autoritaire marqué à la fois par une répression accrue contre les journalistes, les universitaires et l’instauration lente de la charia. Mais la guerre civile en Syrie et l’exode massif de Syriens fuyant à la fois les bombardements du régime de Bachar Al Assad et les exactions de l’État islamique sont en train de rebattre les cartes géopolitiques. Après avoir boudé la Turquie, l’Europe a finalement accepté d’ouvrir un nouveau chapitre des négociations d’adhésion qui font du surplace depuis 2005. De plus, Bruxelles a accepté d’examiner l’une des demandes d’Ankara : la suppression des visas pour les ressortissants turcs circulant dans l’espace Schengen. Deux promesses qui semblent faire partie d’un jeu de dupes.
Dans un paradoxe de l’Histoire, l’Union européenne et la Turquie ont dû se rapprocher pour faire face à la crise des réfugiés syriens. Un rapprochement qui semblait improbable il y a peu, tant les deux entités semblaient s’éloigner l’une de l’autre. Il intervient au moment où le président Recep Tayyip Erdogan glisse de plus en plus vers l’instauration d’un régime autoritaire marqué à la fois par une répression accrue contre les journalistes, les universitaires et l’instauration lente de la charia. Mais la guerre civile en Syrie et l’exode massif de Syriens fuyant à la fois les bombardements du régime de Bachar Al Assad et les exactions de l’État islamique sont en train de rebattre les cartes géopolitiques. Après avoir boudé la Turquie, l’Europe a finalement accepté d’ouvrir un nouveau chapitre des négociations d’adhésion qui font du surplace depuis 2005. De plus, Bruxelles a accepté d’examiner l’une des demandes d’Ankara : la suppression des visas pour les ressortissants turcs circulant dans l’espace Schengen. Deux promesses qui semblent faire partie d’un jeu de dupes. 

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.