 En 1953, Michel Debré est sénateur. Il s’oppose avec véhémence au projet de Communauté européenne de Défense (CED), attaquant nommément Jean Monnet et les « théologiens du transfert de souveraineté ». Un texte, publié dans Politique étrangère en 1953, à relire aujourd’hui, alors que l’Europe traverse une crise aiguë qui fera l’objet d’une analyse détaillée dans le n°4/2011 de Politique étrangère.
En 1953, Michel Debré est sénateur. Il s’oppose avec véhémence au projet de Communauté européenne de Défense (CED), attaquant nommément Jean Monnet et les « théologiens du transfert de souveraineté ». Un texte, publié dans Politique étrangère en 1953, à relire aujourd’hui, alors que l’Europe traverse une crise aiguë qui fera l’objet d’une analyse détaillée dans le n°4/2011 de Politique étrangère.
Quand Démosthène mettait en garde les Athéniens contre Philippe de Macédoine, Démosthène avait raison ! Athènes était une cité, et l’âge venait de plus grands empires. Mais il était deux politiques : l’une qui permettait de les constituer par une alliance et dans la liberté, l’autre qui acceptait de les voir naître de la tyrannie. Nul ne doute, nul n’a jamais douté, que la thèse ardemment défendue par Démosthène fût la seule qui pût garantir l’avenir d’Athènes, celui de la Grèce et de la liberté, la seule qui fût en même temps conforme à l’honneur.
La théorie du transfert de souveraineté
Au départ, nous trouvons la volonté américaine, exprimée dans l’été 1 950, de réarmer l’Allemagne. L’expression de cette volonté a surpris le gouvernement français. Cette surprise n’était pas légitime. Le problème du réarmement de l’Allemagne était posé depuis plusieurs mois. L’invasion de la Corée l’avait projeté, en quelques heures, au premier plan des préoccupations politiques de l’Occident. Il avait déjà été évoqué à la tribune du Parlement, et le blocus de Berlin était de ces signes prémonitoires que seuls les aveugles et les sourds volontaires peuvent ignorer. Cependant, nul, au gouvernement, ou plutôt au sein de nos divers gouvernements, n’avait osé en parler, si ce n’est pour annoncer solennellement qu’il ne pouvait être question de réarmer l’Allemagne…
A la proposition américaine, le gouvernement français a répondu par une proposition dont l’objet était d’« intégrer » des Allemands dans une armée qui n’aurait pas le caractère d’une armée nationale. Cette proposition allait loin dans sa rigueur logique. On n’envisageait même pas un régiment de nationalité allemande ; des soldats allemands étaient placés par petits groupes dans d’autres unités. Projet séduisant, en théorie, mais que sa rigueur rendait difficile à réaliser. Au surplus, à supposer qu’il fut un point de départ, une telle conception du rôle militaire des Allemands ne pouvait se prolonger longtemps.
La proposition française ne fut pas acceptée, même à titre de première étape. C’est alors qu’avec la complicité d’un gouvernement français désemparé et heureux de gagner quelques mois, le consentement d’un gouvernement américain assez incrédule au premier abord, puis convaincu par les affirmations de M. Jean Monnet, le problème du réarmement allemand fut saisi par les théoriciens — je dirai presque par les théologiens — du transfert de souveraineté.
A ce point de l’histoire il convient de revenir quelques mois en arrière.
Le gouvernement américain, avant d’envisager le réarmement de l’Allemagne, avait estimé nécessaire de libérer l’industrie allemande, notamment les mines et la sidérurgie de la Ruhr, des sujétions imposées par les vainqueurs. La situation du monde imposait une révision des idées qui avaient eu cours en 1944. Il était notamment nécessaire d’accomplir un effort pour lier à l’Occident cette grande part de l’Allemagne que les trois alliés avaient prise en charge au lendemain de la capitulation. Il fallait porter l’espoir des Allemands vers l’Occident. Il fallait mettre l’économie allemande au service de l’Occident ; sur cette voie, une première mesure apparut nécessaire : relever ou supprimer le « plafond » maximum de production imposé à l’industrie ; diminuer, et peut-être faire disparaître, les interdictions de fabrication. Voilà sans doute ce qu’il parut très difficile de faire accepter aux opinions européennes, et d’abord à l’opinion française. De cette difficulté jaillit l’idée de chercher quelque moyen exceptionnel de réussite. C’est ainsi que germa le projet d’une « communauté européenne » dirigée par des fonctionnaires impartiaux et recevant des divers Etats le droit de commander à toutes les mines et aux industries lourdes. L’idée, accueillie par M. Robert Schuman, se transforma en une très haute vision d’un « marché commun » et d’une réconciliation politique fondée sur la prospérité que ferait naître ce marché commun.
Lire la suite de l’article sur Persée
 L’ouvrage de Stephen Starr oscille entre récit et analyse sur le vif. Son titre même semble hésiter entre « révolte » et « soulèvement », comme si le terme de « révolution » était par trop fort pour que l’auteur puisse définitivement classer ce qui, en Syrie, aura finalement tourné à une boucherie de plus en plus sanglante, de plus en plus insoutenable. Car c’est autour d’avril de cette même année 2012 que l’auteur clôt son manuscrit.
L’ouvrage de Stephen Starr oscille entre récit et analyse sur le vif. Son titre même semble hésiter entre « révolte » et « soulèvement », comme si le terme de « révolution » était par trop fort pour que l’auteur puisse définitivement classer ce qui, en Syrie, aura finalement tourné à une boucherie de plus en plus sanglante, de plus en plus insoutenable. Car c’est autour d’avril de cette même année 2012 que l’auteur clôt son manuscrit.
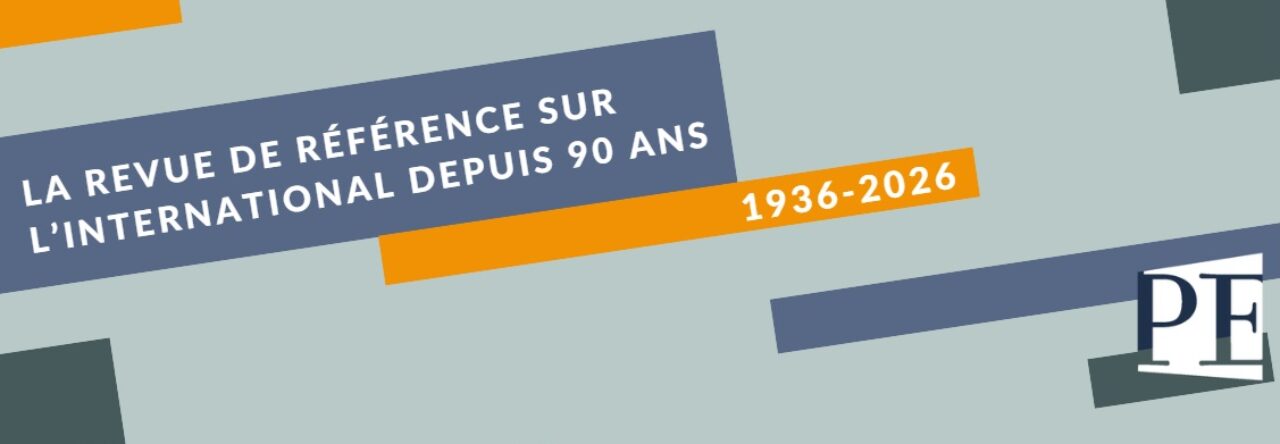



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.