Cette recension d’ouvrages est issue de Politique étrangère (2/2015). Myriam Benraad, chercheur à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM, CNRS), propose une analyse croisée de deux ouvrages : celui de Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech. L’État islamique ou le retour de l’Histoire (Paris, La Découverte, 2015, 187 pages) et celui de Patrick Cockburn, Le Retour des Djihadistes. Aux racines de l’État islamique (Paris, Équateurs, 2014, 174 pages).
 Dans l’abondance d’essais, de récits et de témoignages récemment publiés autour de l’État islamique[1], les ouvrages de Pierre-Jean Luizard et Patrick Cockburn sont particulièrement bienvenus. Rédigés par le spécialiste de l’Irak le plus reconnu de sa génération en France pour le premier, et par un journaliste intimement familier des crises qui déchirent le Moyen-Orient depuis déjà plusieurs décennies pour le second, ils se distinguent par leur sérieux et la rigueur de leur démonstration. Les approches du phénomène djihadiste proposées par ces deux auteurs se complètent : tandis que Luizard illustre, à travers son argumentaire, en quoi l’Occident est tombé dans le « piège Daech », fruit du « retour de l’Histoire » selon lui, Cockburn met en avant la duplicité de ce même Occident qui a longtemps soutenu – et continue à soutenir – des puissances régionales étroitement liées à la mouvance radicale.
Dans l’abondance d’essais, de récits et de témoignages récemment publiés autour de l’État islamique[1], les ouvrages de Pierre-Jean Luizard et Patrick Cockburn sont particulièrement bienvenus. Rédigés par le spécialiste de l’Irak le plus reconnu de sa génération en France pour le premier, et par un journaliste intimement familier des crises qui déchirent le Moyen-Orient depuis déjà plusieurs décennies pour le second, ils se distinguent par leur sérieux et la rigueur de leur démonstration. Les approches du phénomène djihadiste proposées par ces deux auteurs se complètent : tandis que Luizard illustre, à travers son argumentaire, en quoi l’Occident est tombé dans le « piège Daech », fruit du « retour de l’Histoire » selon lui, Cockburn met en avant la duplicité de ce même Occident qui a longtemps soutenu – et continue à soutenir – des puissances régionales étroitement liées à la mouvance radicale.

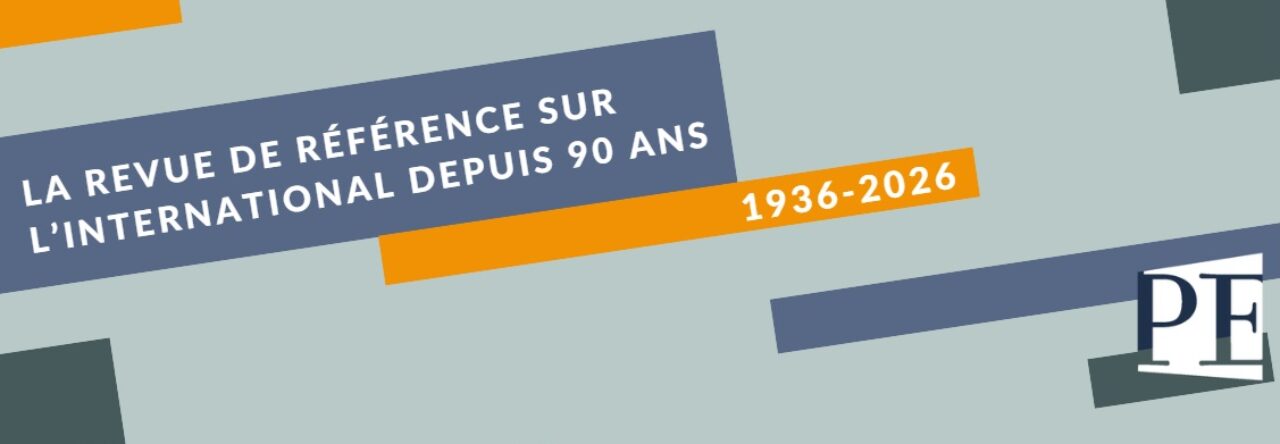
 Comme une masse liquide injectée dans le grand Proche Orient, les territoires conquis par le groupe État islamique fluctuent sur les cartes du renseignement international. Ce que ces cartes ne montrent pas c’est l’assise économique et financière qui explique la fulgurante montée en puissance de Daech et sa force de frappe. L’organisation pèserait environ 2 milliards de dollars. Dans le numéro d’été de Politique étrangère, la revue de
Comme une masse liquide injectée dans le grand Proche Orient, les territoires conquis par le groupe État islamique fluctuent sur les cartes du renseignement international. Ce que ces cartes ne montrent pas c’est l’assise économique et financière qui explique la fulgurante montée en puissance de Daech et sa force de frappe. L’organisation pèserait environ 2 milliards de dollars. Dans le numéro d’été de Politique étrangère, la revue de  Depuis 2012 et la prise de contrôle par les rebelles de plusieurs postes-frontières, l’afflux de combattants étrangers n’a cessé d’augmenter en Syrie. À la fin 2014, près de 15 000 personnes ont ainsi rejoint les rangs de l’opposition à Bachar Al-Assad, dont environ 3 000 Occidentaux. Parmi ces derniers, les Français sont les plus nombreux. D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur en novembre 2014, plus de 1 000 ressortissants français étaient alors impliqués dans les filières syriennes.
Depuis 2012 et la prise de contrôle par les rebelles de plusieurs postes-frontières, l’afflux de combattants étrangers n’a cessé d’augmenter en Syrie. À la fin 2014, près de 15 000 personnes ont ainsi rejoint les rangs de l’opposition à Bachar Al-Assad, dont environ 3 000 Occidentaux. Parmi ces derniers, les Français sont les plus nombreux. D’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur en novembre 2014, plus de 1 000 ressortissants français étaient alors impliqués dans les filières syriennes. Le livre d’Aurélie Daher, issu d’une thèse de doctorat en science politique, est le fruit de plusieurs années d’immersion durant lesquelles elle a mené des centaines d’entretiens auprès de hauts responsables, de militants et de sympathisants du Hezbollah. L’auteur entend apporter ici des réponses aux « interrogations quant à l’avenir du Hezbollah » à travers une étude « de la mobilisation du parti dans son pays d’origine ». Cette dernière repose, selon elle, sur trois catégories : militaire, politique et sociale. On la rejoindra aisément quand elle écrit que le parti a choisi « à partir de 2006 de refermer ses portes à l’observation […] rendant l’accès à son appréhension peu aisé ».
Le livre d’Aurélie Daher, issu d’une thèse de doctorat en science politique, est le fruit de plusieurs années d’immersion durant lesquelles elle a mené des centaines d’entretiens auprès de hauts responsables, de militants et de sympathisants du Hezbollah. L’auteur entend apporter ici des réponses aux « interrogations quant à l’avenir du Hezbollah » à travers une étude « de la mobilisation du parti dans son pays d’origine ». Cette dernière repose, selon elle, sur trois catégories : militaire, politique et sociale. On la rejoindra aisément quand elle écrit que le parti a choisi « à partir de 2006 de refermer ses portes à l’observation […] rendant l’accès à son appréhension peu aisé ».
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.