Suite aux récentes violences qui touchent la Turquie, avec notamment l’attentat qui a eu lieu mercredi 17 février dernier à Ankara, nous vous invitons à relire le dossier sur la Turquie et le(s) Kurdistan(s) du Politique étrangère n°2/2014, à commencer par l’introduction de Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie contemporaine à l’Ifri.
 « En novembre 2013 le maître de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, recevait avec les honneurs Massoud Barzani, président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) irakien, à Diyarbakır, « capitale » kurde de Turquie. Le même Barzani, qui tient efficacement tête au gouvernement de Bagdad, était quelques mois plus tôt à Paris le héros d’une campagne d’affichage vantant le Kurdistan irakien comme « îlot de stabilité au Moyen-Orient ». Au même moment, d’autres Kurdes commençaient à découper en Syrie des enclaves pacifiques en marge de la guerre civile, combattant au passage des groupes djihadistes craints de tous. En Iran même, les guérilleros du Parti de la vie libre au Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, PJAK), cousins du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), semblent hésiter sur la tactique à privilégier face à la répression des mollahs.
« En novembre 2013 le maître de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, recevait avec les honneurs Massoud Barzani, président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) irakien, à Diyarbakır, « capitale » kurde de Turquie. Le même Barzani, qui tient efficacement tête au gouvernement de Bagdad, était quelques mois plus tôt à Paris le héros d’une campagne d’affichage vantant le Kurdistan irakien comme « îlot de stabilité au Moyen-Orient ». Au même moment, d’autres Kurdes commençaient à découper en Syrie des enclaves pacifiques en marge de la guerre civile, combattant au passage des groupes djihadistes craints de tous. En Iran même, les guérilleros du Parti de la vie libre au Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, PJAK), cousins du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), semblent hésiter sur la tactique à privilégier face à la répression des mollahs.
Ces instantanés révèlent une réalité inattendue : le Moyen-Orient vit aujourd’hui un moment kurde. Éternels oubliés de l’histoire, les Kurdes s’imposent partout sur la carte régionale, et pas comme on les attendait. À rebours de l’imagerie bien ancrée du peshmerga et de l’activisme révolutionnaire, ils font désormais beaucoup de politique, et leur quête de respectabilité contraste avec les errements de régimes qui les ont réprimés pendant des décennies.

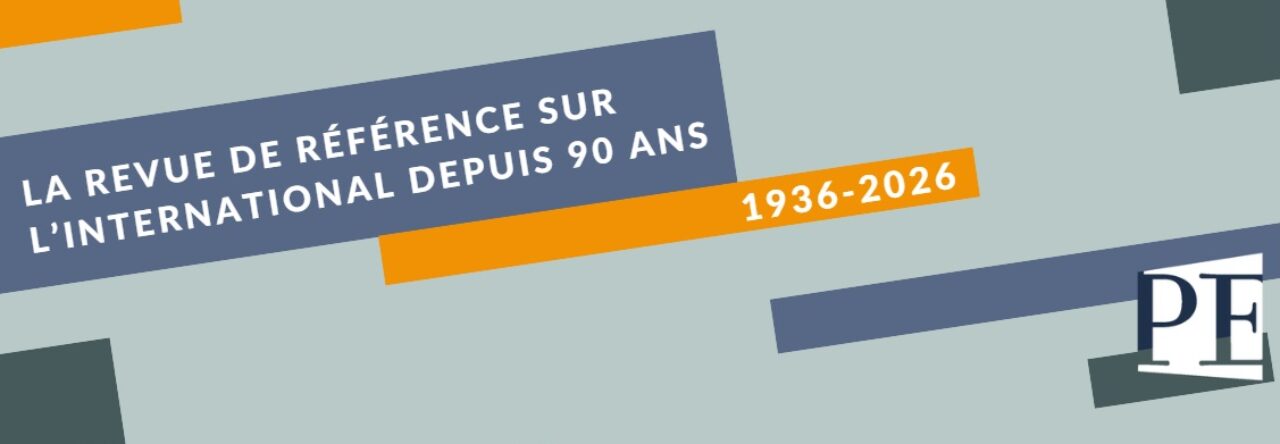
 Dans un environnement en feu, l’Algérie semble étrangement calme, mais les orages s’approchent : chute du prix des hydrocarbures dans une économie très dépendante, baisse d’une rente qui assure la paix sociale, blocage du système politique, déstabilisations du Maghreb (Tunisie, Libye…) et du Sahel (Mali…). Alger se retrouve face à des choix difficiles. Comment régler la succession du président Bouteflika, avec une société de plus en plus dépolitisée mais qui conteste l’opacité du régime ? Est-il possible de diversifier enfin une économie toujours structurée par la rente ? Comment se garder des désordres extérieurs ? Principale puissance militaire de la région, l’Algérie a choisi depuis des décennies le non-engagement extérieur, une option qui n’est plus viable. Au plan interne et au plan externe, le régime va devoir démontrer une souplesse qui lui permette de gérer des situations nouvelles et potentiellement très dangereuses.
Dans un environnement en feu, l’Algérie semble étrangement calme, mais les orages s’approchent : chute du prix des hydrocarbures dans une économie très dépendante, baisse d’une rente qui assure la paix sociale, blocage du système politique, déstabilisations du Maghreb (Tunisie, Libye…) et du Sahel (Mali…). Alger se retrouve face à des choix difficiles. Comment régler la succession du président Bouteflika, avec une société de plus en plus dépolitisée mais qui conteste l’opacité du régime ? Est-il possible de diversifier enfin une économie toujours structurée par la rente ? Comment se garder des désordres extérieurs ? Principale puissance militaire de la région, l’Algérie a choisi depuis des décennies le non-engagement extérieur, une option qui n’est plus viable. Au plan interne et au plan externe, le régime va devoir démontrer une souplesse qui lui permette de gérer des situations nouvelles et potentiellement très dangereuses.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.