 Cette recension d’ouvrage est issue de Politique étrangère (1/2014). Yves Gounin propose une analyse de l’ouvrage de Stéphane Audoin-Rouzeau, Quelle histoire. Un récit de filiation (1914-2014) (Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 2013, 160 pages).
Cette recension d’ouvrage est issue de Politique étrangère (1/2014). Yves Gounin propose une analyse de l’ouvrage de Stéphane Audoin-Rouzeau, Quelle histoire. Un récit de filiation (1914-2014) (Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 2013, 160 pages).
Au milieu de l’abondante production bibliographique que suscite le centenaire de la Grande Guerre, ce court essai retient l’attention à double titre.
D’une part, il est l’œuvre d’un des spécialistes français les plus réputés de la Première Guerre mondiale. Stéphane Audoin-Rouzeau en a profondément renouvelé l’historiographie. En plaçant au cœur de ses recherches le soldat, ses peurs, ses convictions, son libre arbitre aussi, il a combattu l’idéologie pacifiste qui faisait des poilus les victimes d’une boucherie inéluctable.
D’autre part, cet essai ne traite pas à proprement parler de la guerre, mais de ses traces dans une famille, celle de l’auteur lui-même. Stéphane Audoin-Rouzeau tente d’identifier la marque laissée par la Grande Guerre dans sa généalogie. Le témoignage est intime, sans céder à l’exhibitionnisme. Il est subjectif, sans rien renier des pratiques scientifiques de l’historien.
Ses deux grands-pères, nés en 1891 et en 1896, combattirent au front. Le premier livre dans ses carnets l’image, lisse, d’un soldat patriote, combattant par devoir, vouant aux « Boches » une haine atavique. Le second, lui, n’a laissé qu’une seule lettre : une longue description hallucinée des violences qu’ils traversent en août 1916. Ils moururent trop jeunes pour que l’auteur, né en 1955, en discute avec eux. En revanche, le grand-père de son épouse est mort presque centenaire en 1989, et c’est lui que le jeune historien a longuement interrogé lors de la préparation de sa thèse consacrée aux « soldats des tranchées ».

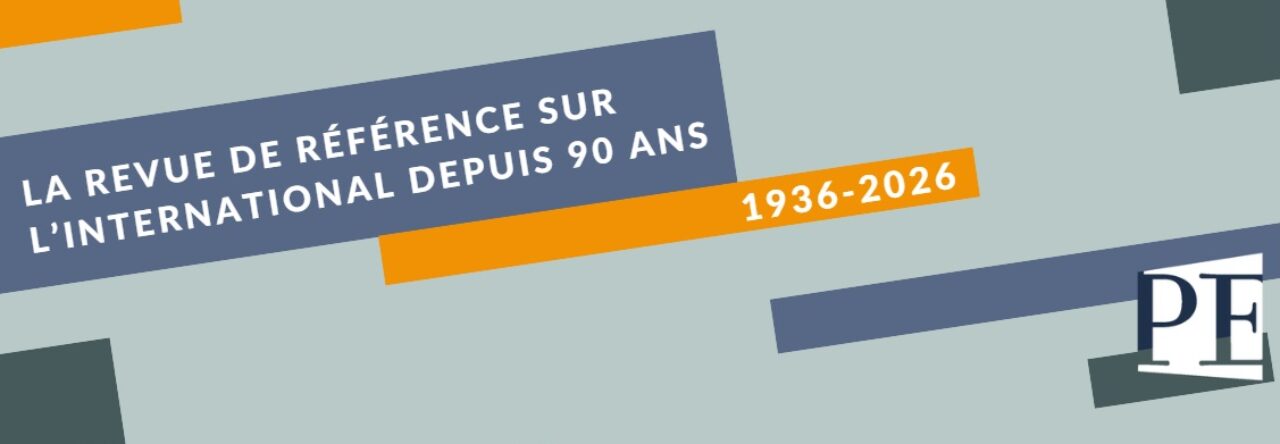



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.