Créée en 1936, Politique étrangère est la plus ancienne revue française dans le domaine des relations internationales. Chaque vendredi, découvrez « l’archive de la semaine ».
* * *
L’article « La Turquie entre la recherche de l’équilibre et l’isolement » a été écrit par le politiste franco-turc Semih Vaner et publié dans le numéro 1/1982 de Politique étrangère.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique extérieure de la Turquie a connu deux périodes relativement distinctes : la première lorsque Ankara s’engagea totalement dans le camp occidental — nécessité oblige, disaient les diplomates et les dirigeants de l’époque ; la seconde commence après le coup d’État militaire de 1960, et, plus précisément, à partir des années 1964-1965, lorsque la diplomatie turque s’efforça de suivre une politique plus équilibrée : rapprochement avec le camp socialiste, normalisation des relations avec le monde arabe, voire à certains moments, une plus grande sensibilité aux thèses du Tiers-Monde dont la Turquie pourrait être considérée, pourtant, à maints égards, comme partie intégrante. Cette recherche de l’équilibre n’a pas suffi, toutefois, à faire sortir complètement le pays de l’isolement ressenti surtout au moment des rebondissements de la crise chypriote : le premier, en 1964, qui est, pour une grande part, à l’origine de cette nouvelle politique, et surtout, le second, plus dramatique, en 1974, où l’intervention au nord de l’île et le peu de soutien qu’elle a trouvé dans le monde a été plus le symptôme de la solitude éprouvée par la Turquie que véritablement la cause.
Lire la suite


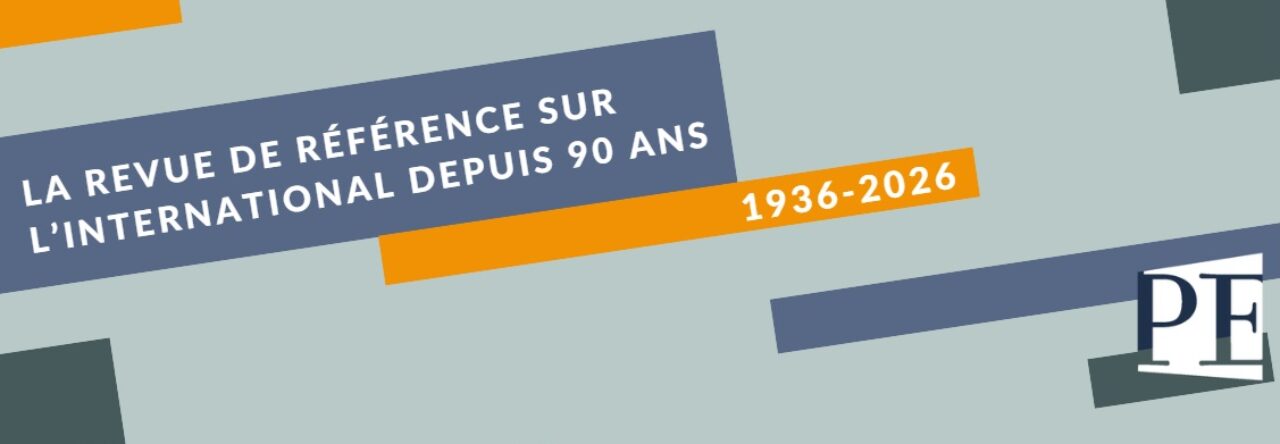



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.